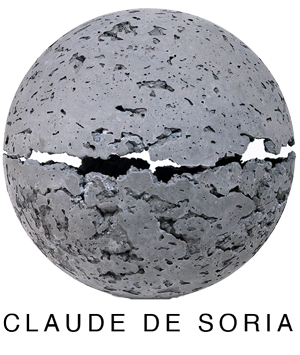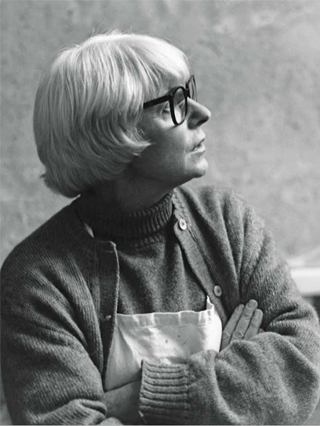Galerie Tendances Exposition, 12 / 1998 – 01 / 1999
Le vocabulaire anglais —à moins que ce ne soit l’esprit anglais— dispose d’un mot qui fait défaut a la langue française : serendipity. En tout cas faisait défaut jusqu’à présent… Jean Jacques, auteur de L’imprévu ou la science des objets trouvés, propose d’introduire « sérendipité » ; mais je n’en suis guère partisan, à cause de la vision fugitive que l’assonance induit d’un serin dépité. Le pauvre volatile déçu sur son perchoir vous discréditerait facilement un concept, et celui de serendipity est à prendre avec le plus grand sérieux. Extrapolé au XVIIIe par Horace Walpole d’un conte intitulé Les trois princes de Serendip, il désigne dans le monde scientifique la propension naturelle des grandes découvertes à se faire par hasard, complètement par hasard. Pas une véritable innovation de notre siècle ou des précédents —les rayons X, la pénicilline, le teflon, pour en citer par exemple trois de mérite inégal— qui n’ait été le fait d’un désordre de laboratoire, d’un concours de circonstances imprévisible, d’une manipulation distraite. La pénétration de l’esprit humain, son aptitude à l’abstraction ou à la déduction n’y sont a priori pour rien.
On ne doit pas pour autant tenir les prix Nobel pour une bande de joueurs de bonneteau. Le hasard heureux de l’invention a besoin d’un témoin de choix, il ne se donne pas au premier venu ou sur présentation d’un simple ticket. Il faut organiser sa
visite, le flatter (sans excès), lui dresser de petits autels —c’est à cela que ressemble le travail des chercheurs. Il faut surtout être en mesure de le reconnaître le jour où il vient à se présenter. La serendipity conduit à trouver tout autre chose que ce que l’on cherchait, éventuellement même l’Amérique, mais pas à trouver si l’on ne cherche pas. Claude de Soria, c’est là que je voulais en venir, a hautement cette faculté d’apprivoiser le hasard qui caractérise aussi les artistes : c’en est à se demander, parfois, si elle ne serait pas de sa famille et l’on perçoit, jusque dans sa politesse tout à la fois distraire et bienveillante, une affinité avec les choses cachées du monde. La série des objets singuliers qu’elle expose aujourd’hui est typiquement le fait d’une collaboration avec l’imprévu. Ils sont issus d’une opération improbable, et d’une idée au départ presque absurde : n’osant refuser a une vente de charité une toile qu’on sollicitait d’elle avec insistance, et bien qu’elle pratiquât depuis longtemps un art fort éloigné de la peinture à l’huile, elle se mit en devoir de faire tenir sur une toile et un châssis une de ces coulées de ciment qui l’intéressent par dessus tout et que l’on a vues souvent exposées depuis 1974, brutes ou montées en lames.
Quiconque à sa place aurait expliqué, refusé courtoisement, au mieux barbouillé une toile et signé de son nom pour être quitte : mais voilà, il n’a pas échappé à l’ange gardien de Claude de Soria que cette demande saugrenue pouvait être un chuchotement du hasard. Ayant fait l’acquisition d’un beau carré de toile de lin enduite et l’ayant soigneusement étalé sur un établi, elle entreprit d’y appliquer une couche de Fondu Lafarge, un ciment brun de bonne facture qui sert habituellement à la construction des ponts et non aux œuvres de l’art, et de couvrir le tout d’une feuille de polyuréthane.
Une des vertus de son art réside dans la très grande modestie des procédures et des matériaux qu’elle met en œuvre : ses sculptures —doit-on leur donner un nom ?— ont souvent le lustre de ces terres cuites japonaises aux couleurs sourdes, qui n’ont pas l’éclat de l’or ou de la porcelaine, mais celui plus durable et en réalité plus précieux du bois des tables polies par des générations de convives, ou du manche des bêches qui ont retourné des années de potager. Ce ciment qu’elle emploie, elle ne le gâche pas, on pourrait dire qu’elle le cuisine : il est moulé dans une feuille plastique, séché, démoulé selon une recette un jour mise au point (par hasard) et infiniment répétée avec de subtiles variantes. À qui aurait dans l’idée le cliché de l’artiste empoignant la matière pour la soumettre à sa vision, en proie à un tourment intérieur qu’il brûle de transmettre à l’univers entier —ce dernier le plus souvent ne lui demandant rien— Claude de Soria semblera une laborantine ou un maçon au petit pied. Mais les artistes n’ont nul besoin de ressembler à leur image d’Épinal, ou de se faire décerner des brevets d’art, comme aurait dit Jean Dubuffet : de Soria en particulier, qui fut l’élève de Léger, mais ne le mentionne que par raccroc, en passant (on serait en peine de chercher chez elle des influences ou des airs du temps).
Elle n’avait rien prémédité : la toile cimentée à l’intention d’une âme charitable, mais peu au fait de l’art d’aujourd’hui, était plutôt destinée à demeurer une exception dans son travail, une fantaisie aimable. C’est en démaillotant l’objet au matin, sans impatience particulière, qu’elle reconnut le double six du coup de dés involontairement lancé la veille. Les mailles de la toile de lin avaient laissé durant le séchage un passage à l’air, nuitamment invité à la fête : pris au piège de la feuille de polyuréthane, recroquevillé dans des poches, des tunnels et une infinité de ramifications, il avait oxydé par endroits le ciment d’une nuance plus sombre. Le dessin évoquait ces jaspes et marbrures subtiles des pierres rares que Roger Caillois a décrit comme personne : le ciment, par la grâce d’une main complice, semblait en quelques heures s’être ressouvenu de ce talent et de cette imagination créatrice dont les minéraux font preuve dans les temps géologiques, si longs et différents du nôtre que nous les prenons pour l’immobilité. On s’émerveille volontiers de ce que la roche parfois s’approche des plus simples manifestations de l’art et qu’on y reconnaisse une silhouette, la figure d’un homme ou d’une ville ; il y a tout lieu de s’émerveiller en retour que les manifestations de l’art puissent ne serait-ce qu’effleurer le génie de la pierre.
J’entends d’ici les protestations : vous n’allez pas, dira-t-on, soutenir que le produit de l’intention artistique et celui du hasard de l’érosion sont de même nature ? Justement si, et très précisément de même nature : ce n’est que par arrogante habitude que nous tenons les faits de notre volonté en plus haute estime que ceux de la nature environnante, ou pour être exact que nous les rangeons dans des catégories distinctes. La culture pourrait bien, comme nous le dit encore Caillois, n’être que le nom donné par les hommes à leur propre nature. Nature et culture ne s’opposeraient que par l’illusion d’une liberté que l’on suppose à l’une et pas à l’autre — et on ne sait pas grand chose par exemple de la liberté qu’a le ciment de s’orner ou pas de dessins en séchant. Une fois le premier coup de dés lancé, rien n’interdit d’explorer, de varier les essais, de solliciter à nouveau le hasard, qui peut se montrer bon prince. L’allure de la dalle de ciment, si finement surfacée par son séjour sur la toile aux normes de la vente de charité, pouvait sans doute être meilleure si lors d’un autre essai on détachait la plaque de son support pour la présenter à part ; il n’y aurait qu’à jeter le support —a moins, comme cela se produisait dans les travaux précédents de Claude de Soria coulés sur film plastique, que la trace laissée par le ciment ne fût elle aussi digne d’intérêt. En dissociant soigneusement les deux éléments d’un second essai, il devint évident que non seulement l’empreinte sur la toile soutenait la comparaison avec la pierre qui l’y avait laissée, mais qu’elle était même là très à son aise, tout à fait de la peinture comme il sied aux toiles, hommage inattendu de la silice et du gypse entre les mains de De Soria à un autre grand amoureux des matières et des empreintes, Jean Dubuffet. Un troisième essai sur une feuille de papier fut moins, ou trop, concluant : le ciment contractait avec le Canson une union si forte qu’il n’était plus question de rupture. Claude de Soria obtint des plaques doublées d’une couche blanche et cotonneuse, délicate, qui lui donna l’idée de les superposer, et le résultat fut à nouveau étonnant. Empilés comme des galets ou des gâteaux secs, ces objets se moquent allègrement des signes extérieurs d’art souvent si prisés : socle, cadre, monture, toutes les étiquettes qu‘on attache pour ranger chaque chose à sa place. C’est une grande vertu que de passer inaperçus aux déchiffreurs d’étiquettes, er de ne pas faire semblant qu’on est là pour de hautes et nobles tâches —les ciments de Claude de Soria savent très bien faire ça.
Les peintres chinois n’hésitaient pas autrefois à signer des pierres. L’Extrême-Orient est plus disposé que nous a tenir pour équivalents, dans l’espace d’une maison par exemple, les agencements spontanés de la nature et les produits de cette même nature contraints par l’artiste ou l’artisan : telle roche découpée, telle racine prendront place, simplement isolées, aux côtés d‘une gravure ou d’un rouleau calligraphié. Un certain Occident —mais pas tout l’Occident, pas celui des cabinets de curiosités ni celui d’André Breton cherchant des agathes au bord des rivières— se persuade qu’il y a un abîme qualitatif entre le fait de ramasser des cailloux, qu’on tient pour inoffensive occupation de retraité, et celui de les représenter en peinture ou de les tailler en sculpture, qu’on classe dans le grand art. Il s’agit en fait de deux versions aussi respectables l‘une que l’autre d’une obsession identique : Claude de Soria se tient comme subtilement à mi-chemin des deux. Suffisamment vigilante et observatrice pour avoir su reconnaître dans un produit de l’industrie ordinaire, le ciment, la plus délicate des matières (une lave tempérée qui passerait sans orages de l’état liquide à l’état solide), suffisamment déférente aux lois du royaume de Serendip pour avoir respecté le savoir-faire du matériau même et s’en être fait un ami.
Didier Semin
Conservateur au Musée National d’Art Moderne