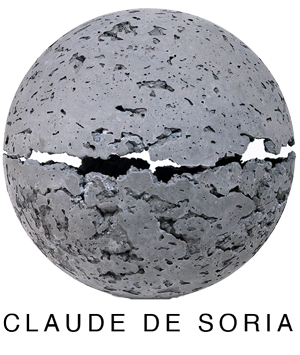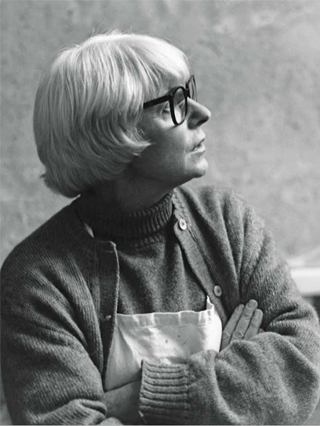In catalogue Claude de Soria, Musée Picasso, Antibes, 1988
Lentement la terre, le sable, l’étendue, lentement la lumière… Il faut entendre Claude de Soria parler de ses œuvres et de son parcours pour comprendre comment s’éveille, s’établit et se fixe le mouvement vif, spontané, inattendu et immédiat (parce que d’une certaine façon toujours différé) de la création artistique. Mouvement vif, trop vite, toujours trop vite, et lent, infiniment lent (qui n’en finit pas) de ce moment bref, de ce lapsus dans le temps, qu’est l’apparition d’une œuvre. Pour l’artiste tout est possible, tout est toujours possible… et rien. Et le tout possible dans le tout impossible, c’est l’angoisse. Et c’est aussi l’angoisse qui précipite les événements. Cette butée du tout possible dans le tout impossible qui cède une nouvelle fois, qui cède à nouveau et comme par accident, comme par surprise, et comme toujours pour la première fois : version et conversion du temps, passage, limite infranchissable, vite franchie…
Mais, la première fois… ?
Si l’on suit la biographie de Claude de Soria on ne peut pas ne pas être frappé par la forme de condensation et de dilatation du temps qui spécifie son mode de création. Après six ans de travail, six ans au cours desquels elle étudie la gravure à l’atelier de Cami, à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, la peinture dans les ateliers d’André Lhote et de Fernand Léger, et découvre la sculpture et le modèle vivant dans l’atelier de Zadkine, Claude de Soria s’éloigne de Paris et semble suspendre toute activité artistique pendant près de cinq ans ; au terme desquels elle reprend, la terre, le modelage, le dessin, comme si de rien n’était, comme la première fois, comme si une fois encore pour la première fois tout restait à apprendre ; ou, qui sait, à oublier, à désapprendre. Il n’est pas inutile de noter que la première œuvre qu’elle expose, à la galerie Claude Bernard, en 1965, est une terre cuite, modèle de sa main gauche, sculptée avec sa seule main droite. On ne reprend pas plus littéralement possession de la disposition instrumentale des possibles et des impossibles de la création. Au demeurant, cette main gauche ouverte (terre cuite de 12 cm de large sur 22 cm de haut) n’est pas sans jouer et déjouer le souvenir que Claude de Soria pouvait alors garder de ces maitres du post-cubisme que furent André Lhote et Fernand Léger. La singulière réussite de cette œuvre tient en effet, selon moi, a ce que sa réalisation participe tout autant de la construction que du modelage, ce qui lui donne tout à tour le caractère frontal d’un relief et/ou d’un volume. Jouant à la fois de son habileté et des limites qu’elle s’impose (travailler avec une seule main) Claude de Soria utilise les inévitables maladresses ou l’entraîne cette contrainte, pour ralentir la création de sa pièce et précipiter un savoir (des souvenirs d’enseignements présents et passés) dans la possible, impossible maîtrise des accidents qui l’obligent à résoudre des problèmes qui ne sont peut être déjà plus les siens, mais justement ceux qui réalisent l’œuvre de l’artiste dans sa plus complète singularité.
J’insiste sur cette terre cuite de 1965 parce que, me semble-t-il, à sa façon, elle prépare, ce que je considère comme le véritable tournant et mouvement initiateur de la carrière de Claude de Soria ; à savoir fin 1966 début 1967, la découverte, lors de la vaste rétrospective de Picasso au Grand Palais (1966/1967), et la fixation sur deux œuvres peintes de la période (1903/1909) encore précubiste, du maître de l’art moderne. Ayant vu l’exposition de Picasso, Claude de Soria décide alors de réaliser en trois dimensions deux toiles peintes par Picasso au cours de l’hiver 1908/1909 : l’Homme nu assis (hiver 1908/1909) et la nature morte Pain sur table (début 1909). Décision qui ne témoigne pas seulement d’une étonnante et immédiate compréhension du caractère sculptural de la peinture de Picasso, mais qui s’emploie d’abord à engager et à traiter aussi explicitement et radicalement que possible ce que la terre cuite de 1965 (« la main »), comme construction et modelage, tendait à manifester de la réalisation et, si je puis dire, de la déréalisation de la figure perçue dans sa présence frontale et volumétrique (tridimensionnelle). La mise au volume des tableaux de Picasso Homme nu assis et Pain sur table, permet à Claude de Soria de saisir, dans l’expérience même qu’elle en fait, le mouvement vif, vite et lent, et quasi-inconscient, qui, fixant l’apparition d’une figure, et sa proximité, la précipite dans l’espace. L’arrêt, la fixation sur le modèle (la main gauche ou le tableau de Picasso), la décision plus ou moins inexplicable de choisir celui-là précisément, se produit spontanément, dans un temps aussi court que possible, alors que la conséquence de cette décision engage le temps forcément autre du développement et de l’élaboration. Si l’on retient le rapport que tout au long de sa carrière Picasso entretient avec la figure, on ne peut pas ne pas constater la maîtrise avec laquelle il joue dialectiquement de ce double mouvement de fixation et d’emportement qui compose chacun de ses tableaux (aussi bien pré-cubistes, que cubistes ou post-cubistes) comme frontalité et volume. C’est ce que, me semble-t-il, perçoit d’abord Claude de Soria lorsqu’elle voit l’exposition Picasso en 1966, et c’est en ce sens que l’on peut considérer l’œuvre de Picasso comme une décisive et importante influence. En témoignent bien entendu les deux pièces dont nous venons de parler, mais non moins cette autre terre cuite dite « Fleur » réalisée en 1963 et formellement extrêmement proche de l’ensemble d’aquarelles, représentant une pomme, que Picasso peint à l’automne 1909. Ce qui laisse supposer que Claude de Soria était préparée, et mieux que préparée, à suivre dans la déréalisation de la figure, la réalisation de cet espace qui, singulièrement, se confronte à la figure et force le mur du temps.
Mais… quel espace ?
On l’aura compris, j’espère, la ligne que suit Claude de Soria n’est en rien dogmatique ou même volontariste. Fixation et emportement, lenteur et précipitation, l’artiste tend à laisser surgir la forme qui, dans ce double mouvement, réalise et fracture la continuité du temps. Et de ce point de vue il n’est pas étonnant qu’elle ait été entraînée à s’écarter d’un mode de représentation trop immédiatement figuratif. Au demeurant n’est-ce pas dans l’expérience même (et quasi technique) de la pratique du matériau qu’elle utilisait que, frappant la terre avec un morceau de bois (fixation et emportement entendus ici au sens littéral), elle découvre que les reliefs, ainsi créés spontanément, témoignent d’une complexité et d’une richesse d’organisation formelle, chromatique et rythmique, ayant sa logique propre en une disposition infinie et telle qu’elle se révèle, susceptible de retenir les évocations les plus diverses. La découverte consiste proprement à donner toute sa dimension spéculative au mot de Matisse : « L’espace a l’étendue de mon imagination. » Ce que moins explicitement sans doute mais incontestablement Claude de Soria va désormais travailler. Non pas dans la dimension que l’on imagine volontiers spectaculaire des conséquences d’un tel propos, d’une telle constatation, mais dans sa confirmation par, si je puis dire, la négative. À la fin des années soixante, à partir de ce pain de terre frappé avec un morceau de bois et livrant en reliefs rythmés le déploiement polymorphe d’une construction quasi scripturale (s’agit-il de l’élévation d’un rempart de terre ou de l’évocation d’une tablette sumérienne, ou d’un tout autre mode d’écrit lié aux qualités propres de la matière ?)… à partir de cette pièce, en tout point déchiffrable et opaque, Claude de Soria engage, limite et ouvre l’espace de toute fixation imaginaire, dans le strict champ des virtualités plastiques du matériau.
Ce qui dans un certain mode de représentation de la figure (de la figuration) joue sur le développement et les longues unités du récit (de la Psyché entendue comme Ego) se trouve alors essentiellement versé au compte des plus petites unités créatrices comme poétique (poiêzis) de l’espace de la manipulation, de la fabrication, du « faire ». Et il n’est pas étonnant que dans une semblable perspective Claude de Soria soit entraînée aà considérer l’œuvre d’Alberto Giacometti, à laquelle elle rend hommage, explicitement hommage, en 1970. L’espace propre à l’œuvre de Giacometti se constitue en effet non d’une intrusion volontariste et massive de l’objet sculpture, mais d’un retrait (fragment : le Nez; Distorsion de l’échelle convenue : l’Homme qui marche ou Figurines de très petite taille, 15 cm.) qui, au-delà et en-deçà, de l’objet propre, révèle la force et la richesse infinies du moment de l’apparition, ou de la disparition (c’est alors tout un), de la sculpture dans l’espace.
Ne l’associant plus à une manifeste référence figurative, ce mode de qualification spatiale, par apparition et disparition, Claude de Soria le livre à la précipitation, quasi chimique, des réactions du matériau à telle ou telle forme de traitement, ce qu’elle dit le « contact avec des processus naturels. »
Mais, quel traitement ?
Claude de Soria semble avoir découvert progressivement qu’en tant que matériau la terre qu’elle travaillait n’offrait de réactions que dans la mesure où la volonté de l’artiste venait surdéterminer les qualités spécifiques de la matière. Pour que la terre réagisse il faut la battre (comme nous avons vu Claude de Soria le faire dans la pièce « Mur » que nous avons citée). C’est la découverte d’un matériau, à la fois moins fortement maîtrisable et plus malléable, le ciment, qui ouvre à l’artiste le champ de ses possibles. Sil faut « forcer » la terre, le ciment, plus ou moins liquide, s’étend de lui-même et ne prend forme qu’à être retenu. Claude de Soria écrit à ce propos : « je laisse le plus possible le ciment agir par lui-même et ainsi j’obtiens un témoignage plastique de sa formation, de son épanchement, des ondes et des bulles d’air qui le parcourent, de sa vie propre. » (Claude de Soria, catalogue de son exposition à l’ARC, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, nov. 1977, janv. 1978) Et c‘est dans, si je puis dire, cette retenue (du mouvement du ciment liquide et de son étendue) à l’aide d’une feuille de matière plastique, que Claude de Soria va révéler une des qualités les plus inattendues et les plus troublantes de ce matériau a priori ingrat. Spontanément et comme la vérification même de ce continent, bien à elle, de la sculpture, qu’elle est en train de découvrir et d’inventer, la première opération de retenue du ciment, quelle fait couler en le comprimant, autant que possible, dans un tissu de plastique, reproduit, à dix ans de distance, la fleur en terre cuite, le bouton de fleur que j’ai rapproché de certaines aquarelles du Picasso de 1909. En lui-même et pour lui-même dans la présence attentive et intime de l’artiste à lui-même et à elle-même, le matériau confirme en fait moins la figure initiale du bouton de fleur en terre cuite que la qualité de la « manipulation » et… ses figures (Faut-il rappeler que l’œuvre de Claude de Soria présente quasi au départ et quasi comme première pièce, la construction modelage en terre de sa main ouverte ?)
Condensation et dilatation du temps ; en un moment, lorsqu’elle dégage le ciment sec du tissu de plastique qui l’enveloppe, ce sont dix années qui se précipitent et se fixent, version et conversion du temps, sur la limite infranchissable… et passée. Et en effet tout un continent de représentations variables et infinies se déploie devant elle, pour elle, avec elle. En ouverture à son exposition chez Baudoin Lebon en janvier 1980, Claude de Soria écrit : « Après les plaques et les boules en ciment, les tiges et les plis sont nés de mon émerveillement toujours aussi vif devant le processus de la transformation de la matière… En somme, je laisse la matière me révéler ce que j’attends obscurément d’elle. » Ce que je préciserai en soulignant que cette « attente » est justement ce qu’en d’autres circonstances on dit une technique (un art), un mode de traitement de la matière. Claude de Soria, son continent, son art ; tout ce qu’elle a accumulé d’attentions sensibles à elle-même et à ce retrait d’elle-même, se fixe et « prend » brusquement, comme on dit du ciment juste avant qu’il ne se solidifie, fusion de la technique, du geste créateur, fusion de l’art et de la création.
Des pièces en ciment, des Plaques de 1974, 1975, aux Boules en deux parties de 1976-1977, 1978, aux Tiges de 1979, 1980, aux Plis de 1980, aux Plis plats de 1981, à la vaste série des Lames et Contre-Lames présentées à la galerie Montenay-Delsol en 1985, à l’actuelle série des Ouvertures, c’est une très grande diversité de réalisations et d’inventions formelles que déploie aujourd’hui l’œuvre de Claude de Soria. Il pourrait sembler que, par exemple, des Boules aux Plis plats l’artiste explore divers modes de présence du volume dans l’espace. Et il en serait sans doute ainsi si, comme l’a justement remarqué Alfred Pacquement, lors d’un entretien avec l’artiste en 1982, pour Claude de Soria l’intérêt pour la sculpture n’était au moins autant commandé par « la peau de la matière, la surface » que par la recherche formelle. Nous avons vu à quel point l’art de Claude de Soria était dépendant de la technique, du traitement du matériau, et comment la forme se trouvait conditionnée par les qualités propres et les dispositions techniques de ce même matériau. Et bien c’est ce conditionnement lui-même, en ce qu’il vient jouer et déjouer l’identité de la figure (Boule, Tige, Pli, Pli-plat, etc.), qui en dernière instance surdétermine et réalise la cohérence unique des volumes dans l’espace. S’il était besoin de démontrer que l’objectif de l’art de Claude de Soria n’est pas d’établir l’identité des figures en tant que telles, la création dans le même temps, et la présentation dans le même lieu, de pièces ayant des titres aussi explicites que Lame et Contre-Lame, y suffiraient amplement. Quelle que soit sa taille, son échelle, qu’elle soit relief ou volume, la sculpture de Claude de Soria définit d’abord sa présence et son organisation spatiale, non pas de la partie au tout mais de la partie pour le tout. Le hasard suscité, l’accident contrôlé, parce qu’assumé, déterminent les qualités d’un ensemble, d’une pièce, d’une sculpture, comme molécule vivante, comme la plus petite portion d’un corps qui puisse exister à l’état libre sans perdre les propriétés de la substance originelle. La complexe richesse chromatique et plastique des surfaces doit son existence à la rigoureuse organisation atomique d’un univers fini/infini, témoignant, du microcosme au macrocosme, d’une respiration en tout point identifiable à celle que nous connaissons et pourtant toujours, encore et à nouveau imperceptiblement étrangère. Réalisée, qualifiée, manifestée par le hasard et la secrète logique de ses micro-éléments la sculpture introduit par effraction et discontinuité les propriétés immanentes de son univers dans la continuité transitive du nôtre. Et c’est bien entendu un hasard, et ce n’en est pas un, si un certain nombre d’œuvres de Claude de Soria évoquent un soleil (astre considéré comme au centre d’un système planétaire) par exemple les Boules, les Plaques et plus encore les Empreintes de ciment sur plastique, et s’il est difficile de considérer les toutes récentes Ouvertures sans penser au disque cosmique, le « Pi » chinois.
Partant des données les plus littérales de l’art de son temps : frontalité-espace volume du cubisme —expérience et trouble existentiels de la distanciation du sujet chez Giacometti— prise en compte de la logique des réactions propre à un certain traitement du matériau, etc., Claude de Soria témoigne à nouveau, à sa façon unique, et toujours comme pour la première fois, de ce qu’il en est d’une œuvre d’art : de ce qu’il en est de l’intrusion dans le monde d’un temps étranger au monde, le temps si l’on veut « ralenti » (comme elle dit elle-même) et précipité, le temps aussi bien cosmique de la matière lorsqu’elle apparaît (terre, sable, étendue, lumière) dans son exaltation, créée, unique, comme la première fois.
Marcelin Pleynet